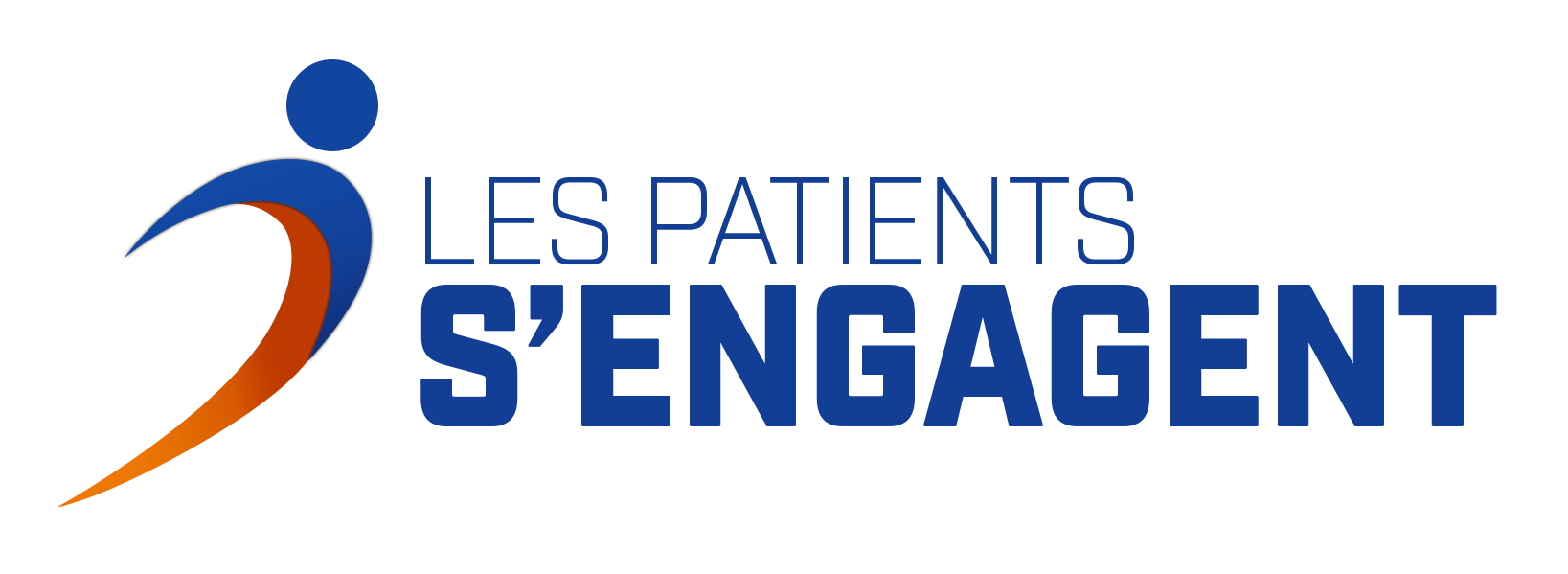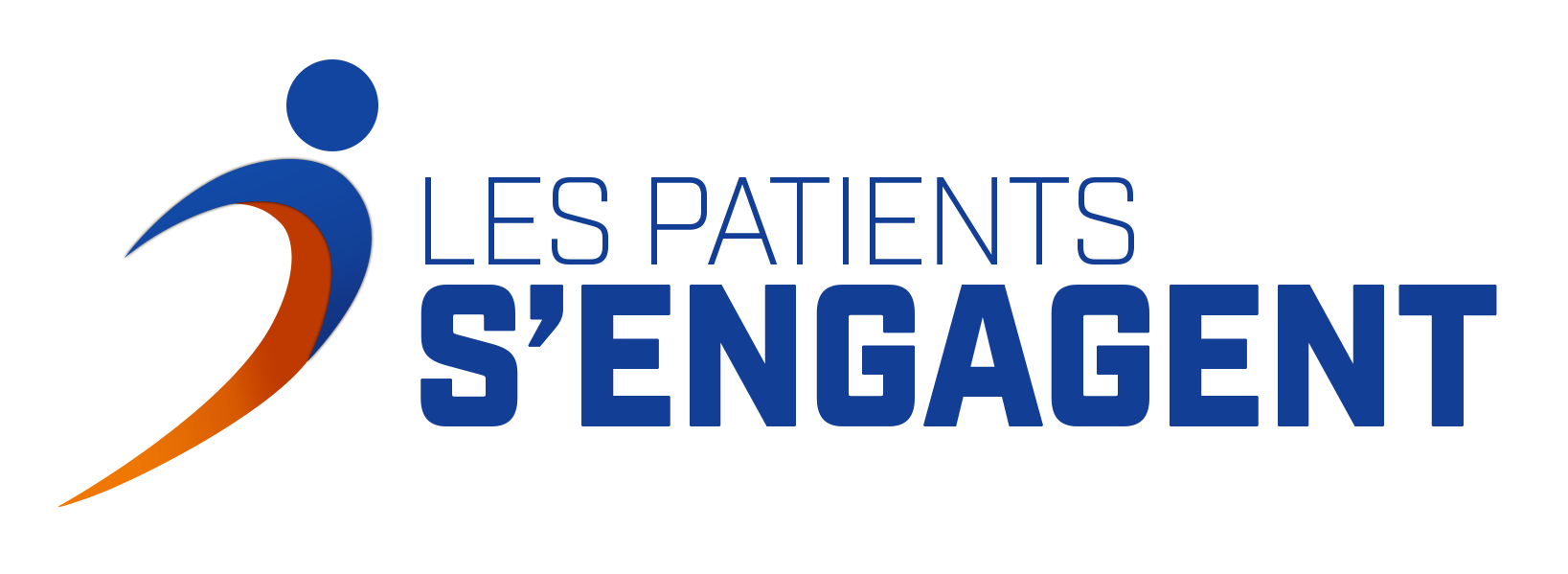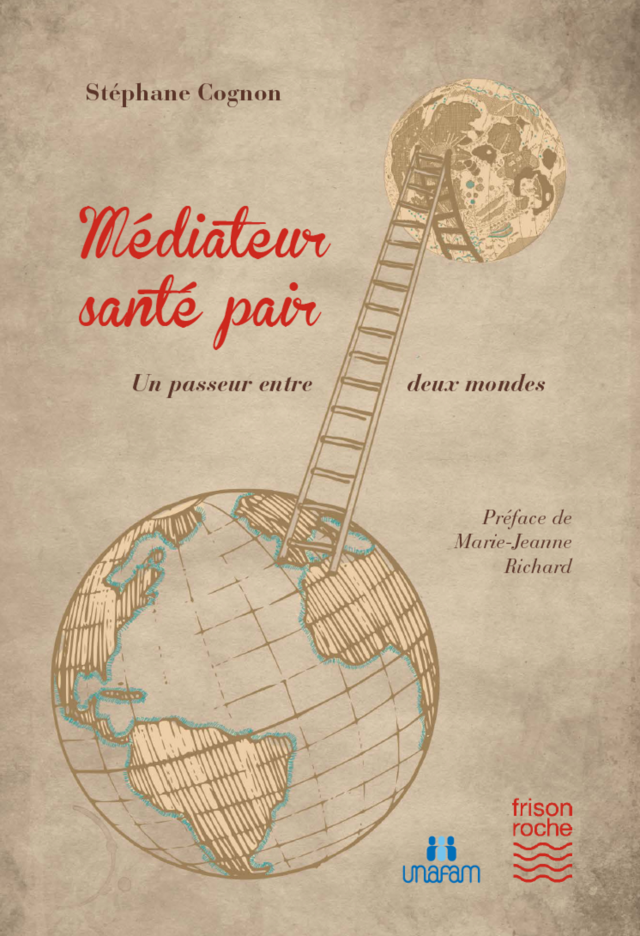JAN-MARC CHARREL, président de France Rein
De la stratégie de soins au plaidoyer, une démarche résolument orientée vers l’autonomisation du patient
Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
J’ai 74 ans, je vis en Haute Savoie, à proximité de Genève. Je suis malade rénal depuis ma plus tendre enfance, ce qui m’a valu d’être élevé dans du coton, privé de tout ce que font les enfants : faire de la bicyclette, jouer au foot…. A l’époque, on ne donnait pas cher de ma vie. On avait dit à mes parents : « si vous croyez en Dieu, priez ! ». Je suis toujours là ! Pendant ma vie d’adulte, la maladie s’est tassée et j’ai essayé de l’oublier. Je me suis marié, je suis devenu architecte. Vers la cinquantaine, alors que des symptômes étaient apparus – démangeaisons, œdèmes … - on m’a annoncé que je souffrais d’insuffisance rénale chronique.
Un bilan sanguin a révélé un taux de créatinine et un débit de filtration glomérulaire élevés qui devaient me préparer à envisager une dialyse ou une greffe à moyen terme. Cette annonce a été brutale. J’ai eu 5 ans pour m’habituer à l’idée, discuter avec ma néphrologue et ma famille des différents moyens de suppléance. Pendant ce laps de temps, un cas de leucémie chez des proches nous a sensibilisés au don d’organe et au don de son vivant. Lorsque le moment de la greffe est venu, après 8 mois de dialyse péritonéale de nuit et à domicile pour limiter le risque professionnel, ma femme m’a donné un rein.
Comment êtes-vous entré dans le monde associatif et comment votre engagement s’est-il ensuite construit ?
Je me suis engagé au début des années 2000, quand on a commencé à parler de dialyse et de greffe. La brutalité de l’annonce de ces traitements m’avait bouleversé. J’ai vu une affiche de la Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR), qui allait devenir plus tard France Rein, dans la salle d’attente du service de néphrologie où j’étais suivi ; je m’y suis inscrit environ un an avant d’être dialysé et me suis très vite investi, au niveau départemental de l’association.
J’ai toujours eu un tempérament de militant, syndical, politique, professionnel… Au sein d’une communauté, c’est aussi se prendre en charge, s’apporter quelque chose à soi en même temps qu’aux autres, voilà pourquoi je me suis engagé. Donc, après avoir occupé plusieurs fonctions, au niveau régional et national, j’ai été amené l’an dernier, en tant que président adjoint, à prendre la succession du président décédé en cours de mandat ; et cette année à me présenter au suffrage de mes pairs.
Quelles sont les missions qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez renforcer ?
Au sein de l’association, notre leitmotiv c’est la qualité de vie du patient et notre moteur, le plaidoyer. Nous développons donc particulièrement ces deux axes-là, pour que chacun devienne acteur de sa santé. C’est essentiel pour faire face à des traitements parfois compliqués. Nous sommes porteurs de messages sur notre pathologie qui est mal connue du grand public et de nos gouvernants. Notre plaidoyer est une forme d’engagement politique par lequel nous défendons notre communauté soit, pas moins de 100 000 personnes si on ne compte que les dialysés et les greffés. Mais 10% de la population est touchée par un problème rénal sans pour autant en arriver à ce stade.
De ce point de vue, les associations ont connu un grand chamboulement avec la Covid. Les dialysés et les greffés sont des malades fragiles et il y a eu un grand nombre de décès au sein notre communauté, de l’ordre de 5 %. Mais comme dans toute épreuve, il y a eu du positif : sur le plan de la communication et sur le plan médical, l’usage massif de la visioconférence et de la téléconsultation a permis de gagner en rapidité et en efficacité tout en réalisant des économies. Ces évolutions sont précieuses pour nous. L’ensemble des centres de dialyse travaillent en tension. Beaucoup de soignants sont épuisés ou en arrêt maladie, ils ne trouvent plus de sens à leur travail.
Cette hémorragie de professionnels est une fragilité qui s’ajoute à celle que vivent les patients dans leur chair. Au centre de dialyse des Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains, par exemple, dont la responsable est la néphrologue qui me suit depuis plus de 20 ans, les temps de dialyse ont dû être réduits à 2 heures au lieu de 4 et on envoie des patients vers d’autres centres du département, voire jusqu’à Genève, faute de pouvoir les prendre en charge. De nombreux centres ont été contraints de mettre en place un mode dégradé de traitement, au risque de mettre les patients sévères, souvent polypathologiques, en grand danger. C’est notre devoir d’alerter les pouvoirs publics sur ces situations.
Quelle est votre démarche auprès des autorités de santé ?
Fin juin, nous avons signalé au ministre de la Santé François Braun ce problème de pénurie de personnel. Cette question - en dialyse mais aussi en transplantation, car la pandémie a occasionné des annulations et d’importantes pertes de chances – a été évoquée lors d’un premier rendez-vous que nous venons d’avoir avec des conseillers du ministre. Nous avons également abordé le sujet de la transplantation qui permettrait de réduire le nombre de dialysés et celui de la dialyse à domicile, qui apparait comme une solution au maintien du temps de dialyse nécessaire, d’autant qu’on a les moyens d’être suivis à distance via les dispositifs numériques. Les deux apportent une meilleure qualité de vie. Mais cette pratique doit être élargie au plus grand nombre - c’est vital pour nous : aujourd’hui à peine 7% des dialyses sont réalisées à domicile. La fourchette varie de 2-3 % dans les régions les moins bien loties à 12-13 % dans les mieux loties, alors que certains de nos voisins européens comme le Royaume Uni ou les pays nordiques, sont bien plus en avance, avec des taux supérieurs à 20%.
Nous avons un sentiment positif à l’issue de cet échange ; il est prévu que nous nous rencontrions à nouveau dans 6 mois pour faire le point sur ces sujets.
Quelles sont vos ambitions ?
Nous allons participer aux travaux de re-fondation du système de santé, notamment dans les territoires, comme l’a annoncé dernièrement le Président de la République. Nous travaillons déjà en partenariat sur différents projets avec la Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT), le Club des Jeunes Néphrologues, la Société Francophone de Transplantation. Mais le cautionnement politique est irremplaçable ; un des conseillers d’Oliver Véran nous a été d’une grande aide lorsque nous sommes intervenus dans le cadre du Plan greffe 2022-2026. Nous sommes, au sein de l’association, plus de 200 représentants des usagers (je le suis moi-même et je préside une Commission Des Usagers) qui avons aussi une mission d’alerte sur le terrain. Ce qui n’exclut pas de remonter le positif, mais c’est en pointant le négatif qu’on construit l’avenir et qu’on l’améliore.
Je suis personnellement très engagé dans le partenariat patient, avec les sociétés savantes et dans des établissements de santé, dans la recherche, et c’est ce que je veux développer le plus possible, avec l’Éducation Thérapeutique notamment. C’est le sens de ma vie de retraité, ce qui me permet de rester créatif, comme je l’étais dans mon métier. Les projets ont une autre forme mais l’esprit est le même.
Ensuite, il faut encourager le don d’organe et notamment le don du vivant, car on manque cruellement de greffons, il faut diversifier les sources. De plus, un greffon issu d’un donneur vivant a une durée de vie de 5 ans supérieure, en moyenne, à celle d’un greffon issu d’une personne décédée. Enfin, nous allons continuer à accompagner les patients réfractaires à la dialyse par peur, parce qu’ils sont mal informés, via la promotion des traitements conservateurs, auxquels on a recours majoritairement en phase palliative mais qui peuvent aussi permettre de sauvegarder la qualité de vie et les organes le temps nécessaires à l’acceptation des traitements.