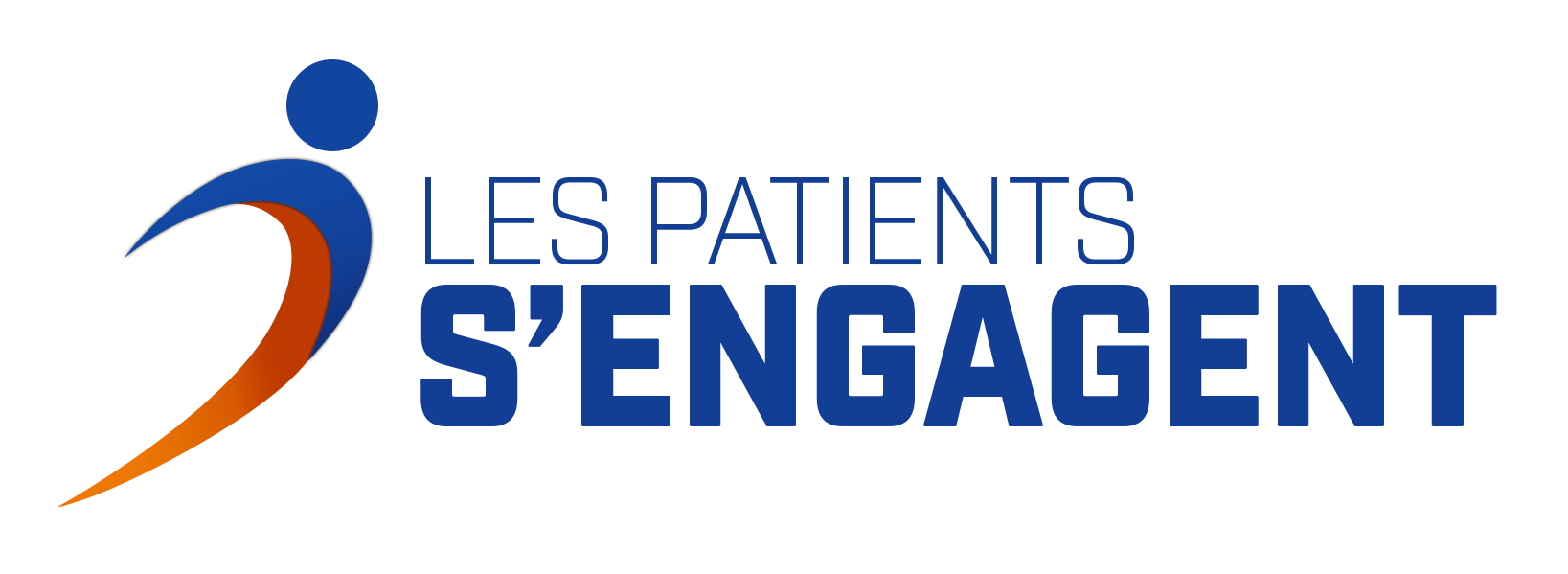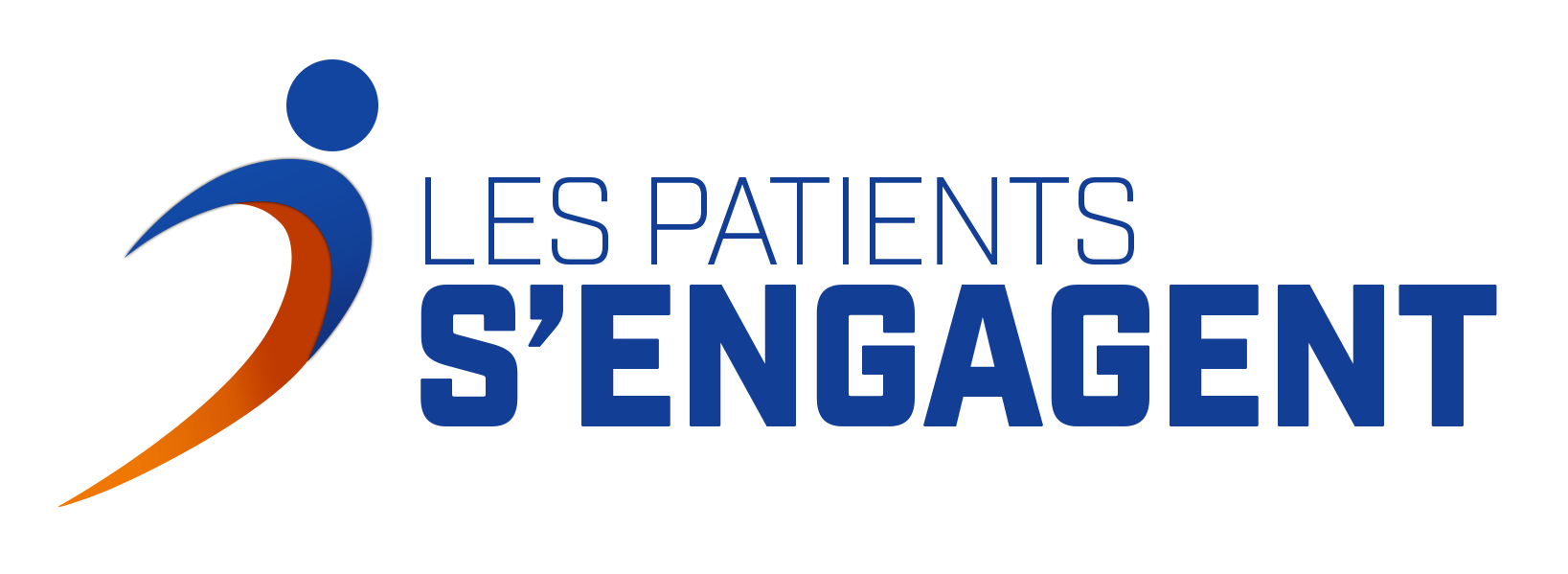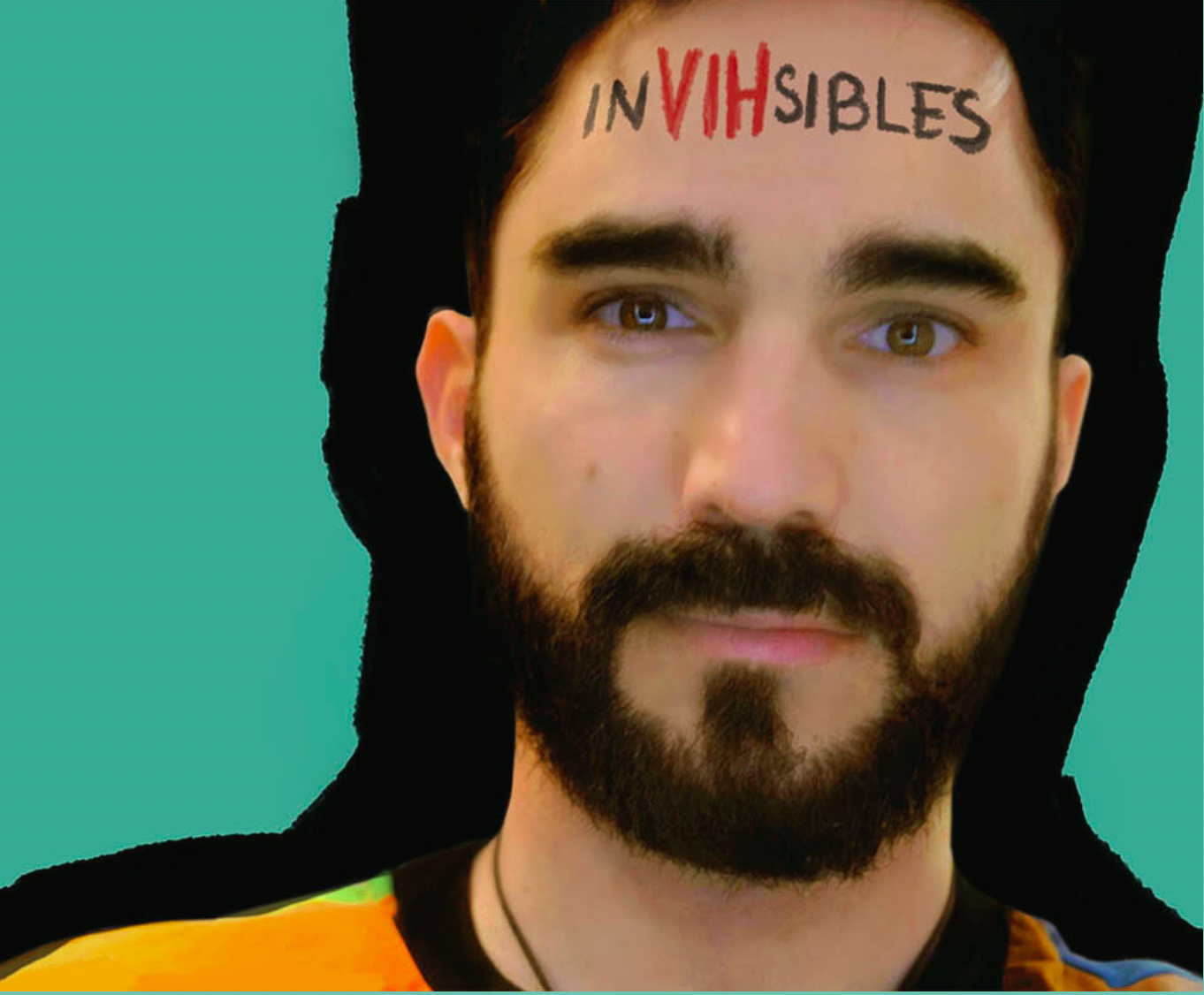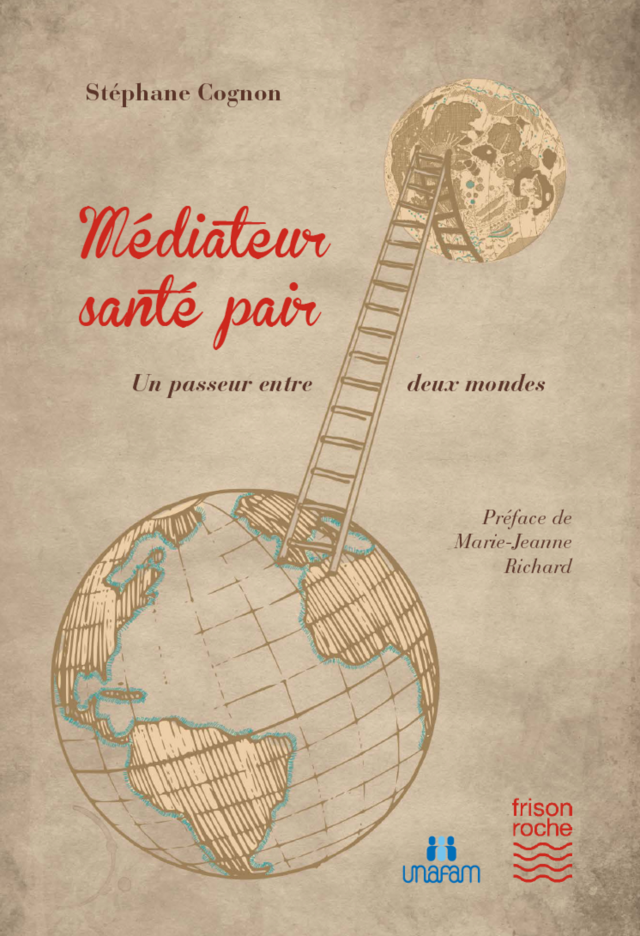NICOLAS ARAGONA, créateur de Supersero
Changer le regard sur le virus du SIDA, en faisant témoigner des personnes vivant avec le VIH
Nicolas, pouvez-vous commencer par nous dire qui vous êtes ?
Je m’appelle Nicolas Aragona. J’ai 35 ans. Je suis né d’un papa infecté d’une hépatite C au tout début de l’affaire du sang contaminé. Dès ma naissance, j’ai été « mis sous cloche ». Je m’en suis sorti, mais toute mon enfance a été structurée autour de la prise en charge de mon père et la sérophobie dont il était victime.
À l’âge de 7 ou 8 ans, je me posais déjà des questions sur cette discrimination. On me disait qu’il fallait que je me « méfie » de mon père, que je ne touche pas à son rasoir, etc. Au collège, j’ai été victime d’homophobie, mais aussi de psychophobie, bien plus tard d’ailleurs, on mettra les mots TDHA sur tout cela. À mes 21 ans, j’ai appris ma séropositivité au VIH.
Pourquoi avez-vous décidé de vous mettre sur les réseaux sociaux ?
Je cherchais ma place. Je ne me retrouvais pas dans les associations. Mais au départ, je ne voulais pas parler sur les réseaux. L’arrivée du Covid m’a poussé à le faire. C’était, en effet, la première fois que je voyais le monde souffrir de questions qui ne s’étaient jamais posées auparavant, pour tous : à travers une infection, est-ce que je suis coupable ou victime ?
Concrètement, j’étais invité à une conférence en visio et j’avais fait un post sur TikTok « Quand tu es séropo et que tu fais une conférence avec les laboratoires ». Elle a fait 20 000 vues.
J’ai alors décidé de faire une autre vidéo, en disant que j’étais une personne vivant avec le VIH. En l’espace de quelques semaines, je me suis retrouvé avec 20 000 abonnés et beaucoup me posaient des questions.
Au début, j’ai apporté mon témoignage. Mais beaucoup de gens me donnaient des réponses et c’est comme cela que j’ai développé mon expertise.
Aujourd’hui, ce que je dis sur les réseaux sociaux, c’est ce que j’ai appris de mes abonnés depuis 3 ans.
J’essaie au mieux d’informer et de lutter contre la sérophobie.
Avec les réseaux, j’ai rencontré des jeunes qui avaient la moitié de mon âge, mais qui étaient engagés dans divers domaines : la santé, les questions sur le consentement et la philosophie, etc. Grâce à eux, j’ai déconstruit tout un tas de biais et cela m’a sauvé la vie.
Quel impact peuvent avoir les réseaux sociaux sur le sujet de la séropositivité ?
Aujourd'hui, le plaidoyer se passe surtout sur les réseaux sociaux.
Pour moi, il est important qu’il y ait une synergie entre les associations et les réseaux sociaux.
Je pense d’ailleurs qu’il serait souhaitable que les associations développent des ateliers qui seraient disponibles pour tous les créateurs de contenus. Ils font un travail de sensibilisation et d’information sur les réseaux sociaux. Ce serait bien qu’ils aient accès à des ressources, qu’ils puissent être encadrés lors d’un cyberharcèlement, et qu’ils puissent aussi avoir un espace pour se politiser. paragraphe
Parlez-moi de votre association Seropo et de vos autres projets.
J’ai créé cette association avec l’objectif de recueillir des témoignages de personnes vivant avec le VIH. Cela me permettait d’avoir un cadre lorsque je fais des interviews ou des conférences ou quand j’aide une personne.
Grâce à cette association, par exemple, avec d’autres abonnés, nous avons élaboré un sondage qui s’adresse uniquement aux séropositifs. L’idée, c’était d’avoir leur point de vue sur ce qui existe actuellement pour eux. La plupart souhaiteraient notamment qu’une ligne téléphonique soit mise en place pour les séropositifs.
Quelles sont vos autres actions ?
J’ai beaucoup d’autres projets. J’ai créé un petit groupe de personnes vivant avec le VIH. Ensemble, on va essayer de mener des actions plus concrètes.
Je voudrais aussi :
● Faire en sorte que les associations créent une ligne SOS sérophobie ;
● Essayer d’inciter les artistes à s’accaparer de ce sujet pour faire des chansons coconstruites avec des personnes concernées.
Et Super Peluche ?
Oui, j’ai créé une peluche en forme de VIH. C’est un projet qui me tient à cœur. Cette peluche permet de rendre visible quelque chose qui ne l’est pas. L’idée, c’est de lutter contre l’invisibilisation des problématiques autour du VIH, et d’imprégner positivement la culture populaire. Les personnes qui l'achètent ont un support pour parler de ce sujet-là.
En plus, cela permettrait à mon association d’avoir une marque inclusive et de ne dépendre d’aucun financement pour fonctionner. Plutôt que d’avoir des subventions, je préfère que les gens s’investissent de cette manière.
Que pensez-vous de la notion de patient expert ?
C’est un concept anglo-saxon qui vient du VIH. De 1981 jusqu’en 1996, la prise en charge médicale du VIH était difficile. Le traitement par AZT, par exemple, tuait autant de personnes qu’il en sauvait. Durant ces 15 années, de nombreuses associations de patients se sont battues pour la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH.
Cela a permis une révolution, notamment en oncologie.
Pour la première fois, on considérait le patient comme le premier sachant. Et cela a tout changé. On a mis en place des ateliers thérapeutiques avec l’idée que le savoir du patient permettait d’élaborer des protocoles plus proches de sa réalité, donc plus efficaces.
Aujourd’hui cette notion se développe pour beaucoup de pathologies de beaucoup de pathologies, mais elle régresse au niveau du VIH. On ne nous considère même plus comme des experts. On est devenu des patients collaborateurs, on nous propose des formations pour éduquer d’autres patients par des ETP. Et cela me choque. Pour moi, il ne s’agit pas d’éduquer le patient, mais de valoriser son savoir pour remettre en question la prise en charge.